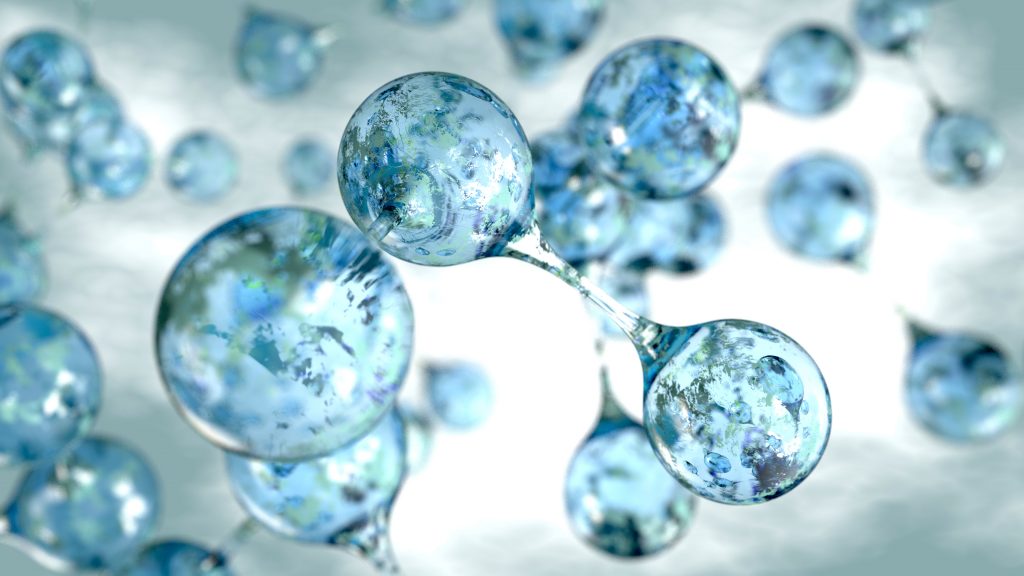Table des matières
Pourquoi l'hydrogène est révolutionnaire pour le stockage de l'énergie
Avec 33,3 kWh/kg, l’hydrogène possède la densité énergétique spécifique de masse la plus élevée de tous les carburants. Cette propriété exceptionnelle en fait le candidat idéal pour la mobilité durable et le stockage de l’énergie dans le cadre de la transition énergétique. Mais son application pratique nécessite des solutions de stockage innovantes, à la fois sûres et efficaces.
Le stockage conventionnel de l'hydrogène et ses limites
Le stockage classique de l’hydrogène s’effectue selon deux méthodes bien établies, qui présentent toutes deux des défis techniques et économiques considérables.
Stockage cryogénique (hydrogène liquide) :
- Température : -253°C (20 K)
- Densité : 71 kg/m³
- Perte d’énergie pour la liquéfaction : 30% de l’énergie stockée
- Refroidissement continu requis
- Des systèmes d’isolation hautement spécialisés sont nécessaires
- Coûts d’exploitation élevés en raison d’une consommation d’énergie permanente
Stockage de gaz sous pression :
- Pression de l’accumulateur : jusqu’à 700 bar
- Perte d’énergie due à la compression : environ 12
- Récipients lourds et résistants à la pression requis
- Densité énergétique pratique réduite en raison du poids du réservoir
- Coûts d’investissement élevés pour les systèmes de compression
Problèmes de sécurité communs aux deux procédures :
En raison de la petite taille de sa molécule, l’hydrogène possède un taux de diffusion exceptionnellement élevé et peut traverser presque tous les matériaux. Comme l’hydrogène n’est pas chimiquement lié, les risques suivants apparaissent :
- Pertes de gaz continues dues à la diffusion du matériau
- Possibilité de dégagements de gaz incontrôlés
- Risque d’explosion avec une concentration d’hydrogène de 4 à 75% dans l’air
- Fuites difficiles à détecter (incolores et inodores)
- La vitesse de gravure élevée rend les mesures de sécurité difficiles

Stockage basé sur la sorption avec des MOF et des hydrures métalliques
Les composés organométalliques d’échafaudage (MOF), les hydrures métalliques et les structures zéolitiques offrent une approche alternative à la fixation mécanique de l’hydrogène par sorption. Ces matériaux réduisent considérablement le risque de diffusion et augmentent la sécurité. Cependant, la plupart des hydrures métalliques présentent des rapports métal-hydrogène défavorables et des vitesses d’absorption et de libération lentes. Une exception notable est le système nickel-hydrure métallique, qui a déjà été largement accepté pour le stockage de l’hydrogène en raison de son application réussie dans la technologie des batteries.
Technologie LOHC : une percée dans le stockage liquide
Les transporteurs d’hydrogène organiques liquides (LOHC), comme le dibenzyltoluène (DBT), révolutionnent le stockage de l’hydrogène. Ce liquide non toxique et difficilement inflammable peut absorber l’hydrogène avec un catalyseur au rhodium dans des conditions modérées de 200°C et 5 bars. Le peroxy-DBT qui en résulte stocke 600 litres d’hydrogène gazeux par litre de liquide, ce qui correspond à une capacité de stockage impressionnante de 2 kWh/kg. Le dégagement se fait à 300°C et sous pression réduite. Les systèmes LOHC atteignent des taux d’absorption et de libération nettement plus élevés que les systèmes de stockage solides, tout en conservant les avantages des faibles taux de diffusion.

Stockage chimique de l'hydrogène par liaison moléculaire
La liaison chimique de l’hydrogène à d’autres molécules offre une autre approche de stockage prometteuse. L’exemple le plus connu est la synthèse Haber-Bosch, qui produit plus de 200 milliards de tonnes d’ammoniac par an. Cette réaction se produit à 450°C et 200 bars en utilisant des catalyseurs à base de fer et atteint un contenu énergétique de 5,2 kWh/kg, ce qui correspond à un rendement de 63%. Bien que l’ammoniac soit plus facile à manipuler que l’hydrogène gazeux, il présente les inconvénients de la toxicité et de la corrosivité. Alternativement, d’autres gaz tels que le méthane peuvent être synthétisés par gazéification du charbon, en traitant la biomasse ou le charbon de bois avec de la vapeur d’eau à haute température.
Méthodes analytiques de caractérisation des matériaux de stockage
L’analyse thermique est l’outil le plus important pour étudier les matériaux de stockage de l’hydrogène. Les analyseurs de sorption gravimétriques et volumétriques, les thermobalances à haute pression (TGA) et la calorimétrie différentielle à balayage (DSC) permettent de caractériser précisément les processus de sorption et de désorption. Ces systèmes permettent de déterminer la chaleur de sorption et de désorption dans des conditions contrôlées de flux de gaz, de pression et de vide. Dans le cas de la gazéification du charbon en particulier, les systèmes TG-DSC haute pression permettent de mesurer simultanément le degré de gazéification, la teneur en carbone et la chaleur de réaction en un seul essai.
Perspectives d'avenir de la technologie de stockage de l'hydrogène
Le développement de technologies efficaces de stockage de l’hydrogène reste un défi majeur pour la réussite de la transition énergétique. Les systèmes LOHC présentent des caractéristiques particulièrement prometteuses pour les applications mobiles, tandis que les matériaux de sorption améliorés sont optimisés pour le stockage stationnaire. Le développement continu de ces technologies sera essentiel pour faire de l’hydrogène un vecteur d’énergie propre et viable pour l’avenir, contribuant ainsi de manière significative à un approvisionnement énergétique durable.